Aussi vieille que la guerre elle-même, les insurrections – et les contre-insurrections correspondantes – sont apparues comme la forme de conflit armé la plus courante à l’ère moderne. Pourtant, de nombreux observateurs occidentaux ne peuvent guère expliquer ce qui constitue une contre-insurrection, encore moins comment en mener une. Les chercheurs britanniques Daniel Whittingham et Stuart Mitchell examinent cette déconnexion et l’évolution de la doctrine et de la pratique de la contre-insurrection au cours des deux derniers siècles en Contre-Insurrection: Théorie et Réalité.
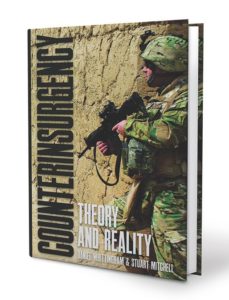
Au début des années 1900, notent Whittingham et Mitchell, les armées européennes avaient acquis une expérience considérable des guerres coloniales et de la “pacification” des populations autochtones. À partir de ces conflits et d’autres “guerres d’empire”, les Européens ont développé un ensemble de techniques de contre-insurrection de base, y compris l’utilisation de camps de réinstallation, de balayages à grande échelle et de mesures répressives pour faire respecter la loi. La doctrine britannique a finalement épousé une coopération civilo-militaire étroite et, dans la mesure du possible, une force minimale, une approche adoptée plus tard par les théoriciens américains.
Néanmoins, la force et la coercition figuraient en bonne place dans la campagne américaine aux Philippines (1899-1903) et la réponse britannique à la guerre d’indépendance irlandaise (1919-21), deux des études de cas les plus convaincantes sur les origines intellectuelles de la contre-insurrection. Plus important encore, les deux reflètent le thème central du livre — que les théories de la contre-insurrection occultent souvent la réalité brutale de la guerre contre-insurrectionnelle. Cela était particulièrement vrai après la Seconde Guerre mondiale, alors que les Français, les Britanniques et les Portugais luttaient pour préserver leurs empires coloniaux en ruine. La conduite des forces de sécurité britanniques au Kenya (1952-60), par exemple, a incité une autorité de premier plan à appeler cette période “l’histoire d’horreur de l’empire britannique dans les années 1950″”
Semblable à certains égards à un conflit anticolonial, le Guerre du Vietnam était sans doute le premier au cours duquel une superpuissance mondiale s’est battue aux côtés et au nom d’une nation “hôte”. Le Vietnam reste historiquement important, soutiennent les auteurs, car il est fréquemment cité comme “un exemple de campagne ratée. »Les critiques soutiennent que la guerre n’était pas gagnable, et lorsque les États-Unis ont tenté de mener des opérations de contre-insurrection, le corps d’officiers caché et borné de l’armée a bâclé le travail. Une grande partie du blâme tombe sur Général William Westmoreland, chef du Commandement de l’Assistance militaire, Vietnam. Ses détracteurs allèguent qu’il manifestait peu d’intérêt pour la contre-insurrection et qu’il menait plutôt une guerre d’usure infructueuse fondée sur le dénombrement des corps.
Whittingham et Mitchell présents une vision plus nuancée de la guerre. Reconnaissant que certainschercheurs « jugent tout ce que les États-Unis ont fait au Vietnam comme un échec simplement parce qu’ils ont perdu”, ils soulignent à juste titre que Westmoreland faisait face à une puissante menace conventionnelle ainsi qu’à une insurrection enracinée. Comme le déplorait l’ancien chef du MACV, il ne pouvait pas simplement ignorer les grandes unités ennemies sans inviter au désastre.
L’Armée n’a pas non plus rejeté l’importance de la contre-insurrection. ”Les États-Unis ont investi davantage dans leur effort de contre-insurrection que ce qui est souvent réalisé », affirment les auteurs. “En fin de compte, les États-Unis ont perdu leur guerre au Vietnam non pas parce qu’ils n’ont pas su apprendre ou faire de la « contre-insurrection correctement »; au contraire, ils ont perdu malgré leurs efforts pour forger une stratégie efficace et non parce que cet effort manquait du tout. »Au contraire, les États-Unis n’avaient pas la capacité de refaire un pays politiquement fracturé au milieu d’une guerre civile acharnée.
Pour conclure avec un examen approfondi de la « contre-insurrection moderne » en Irak et Afghanistan, Contre-Insurrection: Théorie et Réalité nous rappelle que le contexte historique compte. Ce qui a fonctionné dans le passé peut ne pas nécessairement fonctionner dans le présent — et même les théories de contre-insurrection les plus bien intentionnées et éclairées reposent dans une large mesure sur la force et la violence. V
Cet article contient des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose sur notre site, nous pourrions gagner une commission.
Cet article est paru dans le numéro de février 2022 de Vietnam magazine. Pour plus d’histoires de Vietnam magazine, abonnez-vous et visitez-nous sur Facebook.

